Une culture qui considère la connaissance comme un moyen d’atteindre une fin invite à l’utilisation abusive des nouvelles technologies.

En 1940, le traducteur et éducateur AJ Jenkins organisa une enquête sur les habitudes de lecture des enfants de la classe ouvrière. L’étude, principalement menée auprès d’élèves qui quittaient l’école pour entrer sur le marché du travail à 14 ans, examinait leurs lectures hors programme scolaire au cours du mois précédent. Jenkins s’inquiétait du fait que les garçons, en particulier, lisaient trop peu, et ne lisaient que des romans policiers ou des romans d’aventure. Pourtant, du point de vue du XXIe siècle, ce qui ressort, c’est la profondeur de leur lecture d’œuvres classiques.
Parmi les livres que les enfants avaient lus le mois précédent figuraient Le Voyage du pèlerin , Les Voyages de Gulliver , Jane Eyre , Les Mémoires de Pickwick et Le Moulin sur la Floss . Les garçons avaient lu entre quatre et six livres, les filles un ou deux de plus.
C’est une liste, et un appétit pour la lecture, qui pourraient constituer un défi pour beaucoup aujourd’hui. Des enquêtes suggèrent que
les enfants comme les adultes lisent moins qu’avant et y trouvent moins de plaisir. Même les étudiants universitaires semblent avoir des difficultés. Le professeur d’Oxford Jonathan Bate affirmait l’année dernière que là où autrefois les étudiants pouvaient lire trois livres par semaine, ils peinent aujourd’hui à en terminer un en trois semaines. D’autres ont suggéré que les étudiants ont
du mal à lire des livres entiers – une perception qui se retrouve également outre-Atlantique.
La transformation des universités en entreprises a conduit de nombreuses universités au bord de la faillite.
Ces affirmations sont souvent contestées, et on perçoit parfois un relent de panique morale. Néanmoins, le contraste avec les habitudes de lecture d’il y a un siècle notamment chez les ouvriers est à nouveau frappant.
« J’étais assis là, sur ma boîte à outils, à un demi-mile de la surface », a écrit le mineur du Nottinghamshire GAW Tomlinson dans son autobiographie Coal-Miner , « à un mile de l’église la plus proche, et apparemment à des centaines de miles de Dieu, lisant Les Contes de Canterbury , les Essais de Lamb , L’Origine des espèces de Darwin , La Ballade de la geôle de Reading de Wilde , ou tout ce que je pouvais trouver. »
Un jour, il était tellement absorbé par le poème d’Oliver Goldsmith, Le Village désert , qu’il laissa des bacs remplis de charbon s’écraser sur des bacs vides.
Tomlinson n’était pas le seul à être obsédé par l’apprentissage. Dans son ouvrage classique, La vie intellectuelle des classes ouvrières britanniques , Jonathan Rose exhume l’histoire cachée des travailleurs du Lanarkshire au sud du Pays de Galles, et leurs luttes pour s’instruire, créer leurs propres bibliothèques et universités et accéder à un monde culturel qui leur était refusé par les fractures de classe et d’éducation.
Le plaisir de la connaissance a transformé, selon les mots du mineur de la vallée de Cynon, Robert Morgan , qui devint plus tard poète et graveur, « les mineurs effectuant des travaux subalternes et dangereux dans les entrailles de la terre » en « êtres humains privilégiés exposés à quelque chose d’extraordinaire ».
Cette tradition de la classe ouvrière et le sentiment de la valeur de l’apprentissage qu’elle incarnait se sont peut-être érodés, mais la comprendre permet d’éclairer non seulement le passé mais aussi le présent.
Prenons par exemple le débat actuel sur l’impact de l’IA sur les habitudes de lecture et de réflexion. La plupart des étudiants universitaires utilisent désormais des modèles d’IA générative , tels que ChatGPT, principalement pour la recherche. Cependant, on s’inquiète de plus en plus des possibilités de tricherie , par exemple lorsque les étudiants font passer des textes générés par l’IA pour les leurs dans leurs devoirs et leurs dissertations. Nombreux sont ceux qui s’inquiètent également de l’ impact sur les compétences cognitives humaines et sur notre aptitude à la créativité et à l’esprit critique.
Comme tout nouvel outil puissant, l’IA a le pouvoir d’améliorer et de dégrader nos vies. Il est important que les autorités universitaires réfléchissent à la manière de préserver l’intégrité académique et de repenser les modalités d’évaluation des étudiants. Cependant, dans une grande partie du débat, le problème est perçu par le mauvais côté de la lentille. Ce n’est pas tant l’IA qui est à l’origine de la dégradation de la lecture et de la pensée, mais plutôt le fait que la création d’une culture qui considère le savoir principalement comme instrumental a facilité son utilisation abusive.
En 1963, le rapport Robbins sur l’enseignement supérieur britannique plaidait en faveur du développement des universités, arguant que l’apprentissage était un bien en soi. « La recherche de la vérité », insistait le rapport, « est une fonction essentielle des établissements d’enseignement supérieur ».
Si la connaissance n’est qu’une marchandise, pourquoi ne pas tricher pour contourner le besoin de penser ?
Un demi-siècle plus tard, le rapport Browne sur le financement de l’enseignement supérieur, publié en 2010, avait un ton très différent. « L’enseignement supérieur est important », insistait-il, car il permet aux étudiants d’obtenir « des salaires plus élevés et une plus grande satisfaction professionnelle », facilite « la transition professionnelle » et contribue à « générer de la croissance économique ».
Le message central, a observé l’historien et critique Stefan Collini , était que « nous ne devrions plus considérer l’enseignement supérieur comme la fourniture d’un bien public » mais plutôt comme un « marché réglementé dans lequel la demande des consommateurs, sous la forme du choix des étudiants, est souveraine ».
La transformation des universités en entreprises a conduit de nombreuses universités au bord de la faillite et les a conduites à supprimer des matières jugées insuffisamment « commerciales », notamment l’histoire , la musique , les classiques et la littérature .
Compte tenu de tout cela, est-il surprenant que beaucoup considèrent l’IA comme un outil non pas destiné à faciliter la réflexion, mais à la remplacer ? Après tout, si la connaissance n’est qu’une marchandise dont l’achat permet de réussir un examen ou de décrocher un emploi, pourquoi serait-il important de tricher ou d’utiliser l’IA pour contourner le besoin de réfléchir ?
Tant que nous ne reconnaîtrons pas que le débat sur l’IA ne porte pas uniquement sur les capacités des machines, mais aussi sur la valeur que les humains devraient accorder à l’éducation et au savoir, il restera confus. C’est pourquoi les histoires de personnes comme Tomlinson et Morgan, et leur reconnaissance de la valeur humaine du savoir, conservent toute leur importance aujourd’hui.
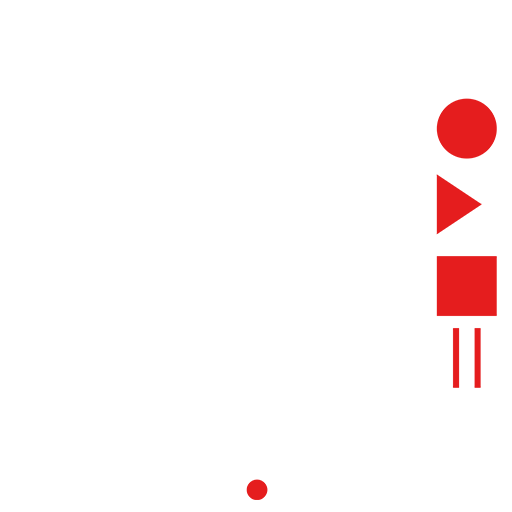

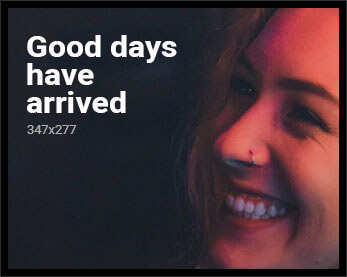
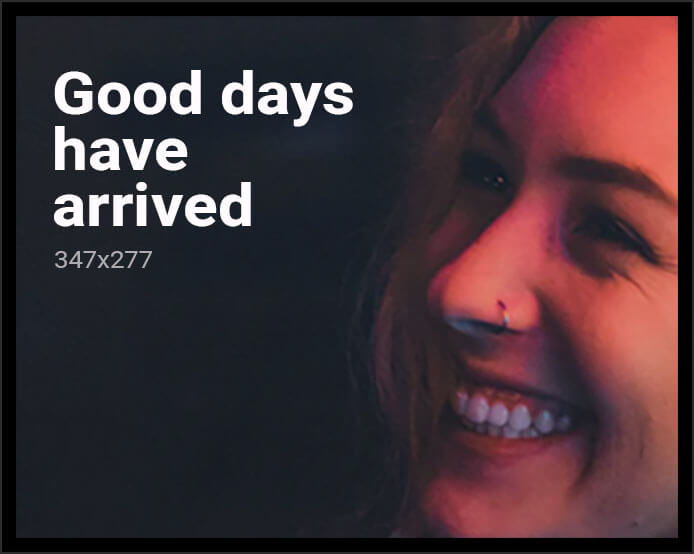
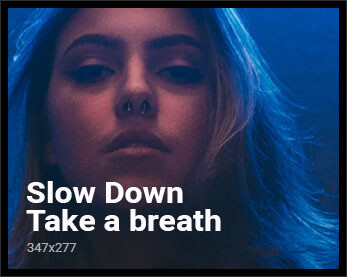
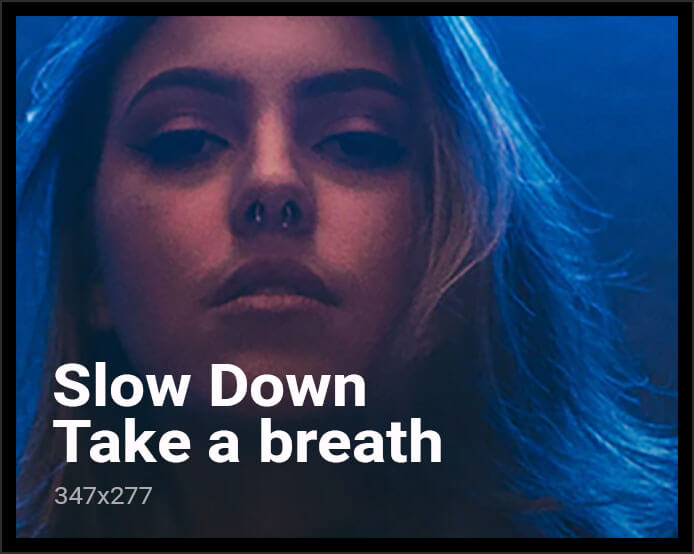

De toute les façons, l’innovation n’attend personne.
Ce n’est pas tant l’IA qui est à l’origine de la dégradation de la lecture et de la pensée, mais plutôt le fait que la création d’une culture qui considère le savoir principalement comme instrumental a facilité son utilisation abusive.
Merci!